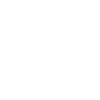La gestion efficace des deniers publics est primordiale puisque les marchés publics représentent environ 10% du PIB français. Une bonne exécution garantit que l’argent des contribuables est bien utilisé : la qualité du service public est directement impactée par l’exécution des marchés. Il y a donc un important travail de suivi autour des prestations, tant sur le plan technique que financier et administratif. Explications des règles et bonnes pratiques d’une exécution maîtrisée, avec les éléments de notre formation “L’exécution des marchés publics (Organiser la gestion administrative et financière en cours de marché)”.
Dans quelles conditions sont exécutés les marchés publics ?
Tout marché public doit être exécuté en respectant son cahier des charges et ses pièces contractuelles. Chaque marché public repose en effet sur un cahier des charges (CCTP, CCAP) qui définit précisément les prestations attendues : spécifications techniques, quantités, délais, lieu d’exécution, normes à respecter, etc. Ces stipulations s’imposent au titulaire, qui ne peut s’en écarter sans accord préalable du pouvoir adjudicateur.
Le contenu des pièces marché est complété par les mentions figurant dans l’offre du prestataire (mémoire technique, bordereau de prix, etc.). L’ensemble forme le socle contractuel sur lequel les parties seront amenées à s’appuyer tout au long de l’exécution. En cas de contradiction entre les documents, un ordre de préséance est prévu au règlement de consultation pour hiérarchiser leur valeur juridique.
L’exécution d’un marché implique des engagements réciproques pour les signataires :
- L’acheteur doit mettre à disposition les informations et moyens nécessaires à la réalisation des prestations : accès aux locaux, fourniture de matériels, validation des livrables, etc.
- Le titulaire doit exécuter le marché conformément aux prescriptions et dans le respect des délais impartis. Il a un devoir d’information et de conseil sur les contraintes techniques ou réglementaires susceptibles d’impacter le projet.
Très souvent, ces conditions d’exécution comportent des clauses sociales (insertion de publics éloignés de l’emploi), environnementales (performances énergétiques, réduction des déchets) ou d’innovation qui engagent également le prestataire.
Quelles règles appliquer en cas d’aléas ou de différends ?
L’encadrement strict des modifications en cours d’exécution
Avec le code de la commande publique, le régime des modifications de marché a été clarifié. L’objectif est de concilier souplesse et prévisibilité contractuelle sans remettre en cause les conditions initiales de mise en concurrence. Désormais, un marché peut être modifié sans nouvelle procédure dans 6 cas limitatifs :
- Modifications prévues dans les documents contractuels initiaux (clauses de réexamen)
- Travaux, fournitures ou services complémentaires devenus nécessaires
- Modifications rendues nécessaires par des circonstances imprévues
- Remplacement du titulaire suite à une opération de restructuration
- Modifications non substantielles
- Modifications de faible montant (seuils de 10 à 15% du marché initial)
Hors de ces cas, toute modification significative doit faire l’objet d’un avenant et peut imposer une remise en concurrence via un nouveau marché.
Les recours et sanctions applicables
En cas de manquement du titulaire à ses obligations, plusieurs leviers existent pour obtenir l’exécution du marché ou sanctionner les défaillances :
- Mise en demeure de s’exécuter sous astreinte financière
- Application de pénalités de retard, d’indisponibilité ou de performance
- Exécution aux frais et risques du titulaire défaillant
- Suspension des paiements en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution
- Résiliation pour faute en cas de manquement grave aux obligations contractuelles
- Saisine du juge administratif par voie de référé provision, référé instruction, recours indemnitaire ou recours en excès de pouvoir
- Sanctions pénales en cas de faux, usage de faux ou escroquerie
Côté acheteur aussi, tout manquement est susceptible d’engager sa responsabilité quasi-délictuelle pour faute : retards de paiement, rupture abusive des relations, modification unilatérale du contrat, etc. En amont du contentieux, une résolution amiable des litiges doit cependant être recherchée via la médiation, la conciliation ou le recours aux comités consultatifs de règlement.
Comment gérer la dématérialisation des factures avec Chorus Pro ?
Depuis le 1er janvier 2020, la facturation électronique est devenue obligatoire pour tous les titulaires de marchés publics, via le portail Chorus Pro. Cette plateforme gratuite et sécurisée permet de centraliser le dépôt, la réception et la transmission des factures entre les entreprises et les administrations. Pour les acheteurs publics, cette dématérialisation est un levier d’efficacité et de traçabilité :
- Réduction des délais de traitement et de paiement des factures
- Diminution des risques d’erreur et des coûts de gestion
- Suivi en temps réel de l’état d’avancement des factures
- Contrôle automatique des données et de la mise en conformité des pièces
- Amélioration du pilotage budgétaire et comptable des marchés
Néanmoins, la bascule vers le 100% démat’ implique beaucoup de changement, plusieurs années après. Pour accompagner cette transition, l’AIFE (Agence pour l’informatique financière de l’État), qui gère Chorus Pro, met à disposition des tutoriels, webinaires et un service d’assistance dédié. De leur côté, les éditeurs de logiciels proposent des solutions de gestion interfacées pour automatiser le transfert des données entre Chorus Pro et les outils de gestion financière, comptable et achats des entités publiques.
Quelles sont les règles encadrant les relations de sous-traitance durant l’exécution des marchés ?
Dans les marchés publics, le titulaire est souvent amené à sous-traiter l’exécution de certaines parties du marché, mais à condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement. Pour les acheteurs, cette procédure vise à s’assurer de la fiabilité et des capacités du sous-traitant à réaliser les prestations qui lui sont confiées.
Elle permet aussi de sécuriser sa rémunération en imposant des garanties de paiement !
Concrètement, le titulaire doit, dès la conclusion du contrat de sous-traitance ou au plus tard avant le démarrage de l’exécution, transmettre à l’acheteur :
- Une déclaration mentionnant la nature des prestations sous-traitées, le nom et les coordonnées du sous-traitant, le montant des sommes à payer directement
- Une déclaration du sous-traitant justifiant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction de soumissionner
- Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant
- L’exemplaire unique du titulaire ou le certificat de cessibilité du contrat
L’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions interviennent via un acte spécial signé des deux parties et annexé au marché.
En cours d’exécution, le pouvoir adjudicateur doit se mettre en relation directe avec les sous-traitants qu’il a acceptés et agréés pour le paiement de leurs prestations dans un délai global de 30 jours. En fin de contrat, il notifie au sous-traitant la date de réception des travaux et adresse copie au titulaire du marché.
Quels sont les points de vigilance au moment des paiements ?
Au-delà de l’obligation de respecter le délai global de 30 jours, les acheteurs doivent être vigilants sur plusieurs aspects des réglements.
D’abord le séquencement des paiements, qui diffère selon la nature et la durée du marché :
- Pour les accords-cadres, les paiements interviennent à chaque bon de commande sur la base des quantités réellement exécutées
- Pour les marchés à tranches, un prix global est fixé par tranche ferme et un décompte est établi à l’issue de chacune d’entre elles
- Pour les marchés reconductibles, les paiements suivent le rythme annuel des reconductions
Ensuite les stipulations relatives aux avances, acomptes et paiements partiels définitifs :
- Les avances sont versées avant tout commencement d’exécution pour faciliter le démarrage des prestations et la trésorerie des entreprises. Elles sont remboursées par précompte sur les sommes dues au titulaire.
- Les acomptes correspondent à des versements effectués au fur et à mesure de l’exécution du marché. Ils doivent être payés au moins tous les 3 mois en fonction de l’état d’avancement.
- Les paiements partiels définitifs rémunèrent un service fait non encore inclus dans un acompte. Ils ont un caractère libératoire et ne peuvent plus être remis en cause.
Enfin le traitement des cessions et nantissements de créances, par lesquels le titulaire transfère tout ou partie de sa créance sur l’acheteur à un établissement financier (banque factor). Notifiées obligatoirement au comptable assignataire, ces garanties nécessitent une attention particulière afin de ne pas bloquer le paiement.